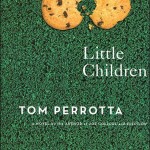 Si on ne lit que Revolutionary Road, il semblerait que le malheur des Wheeler est lié à un problème de contraception. Si leur premier enfant était arrivé plus tard, si le troisième n’était pas arrivé… Si la contraception et l’avortement avaient été permis, le sort des Wheeler aurait-il été meilleur ? Si on se souvient de notre précédent post et notre diagnostic, les Wheeler souffrent tous les deux de bovarysme, il est fort probable que non. Sara certes ne se suicide pas à la fin du roman, mais n’est pas plus heureuse qu’April, sa fille unique était pourtant désirée. Quoiqu’il arrive, la réalité déçoit les deux héroïnes (bovarysme), elles ne savent pas exister, mais seulement rêver leur existence. Par conséquent, April et Sara (même si sa grossesse était prévue) deviennent mère avant de s’être trouvées comme femme. La maternité ne leur permet pas de se trouver.
Si on ne lit que Revolutionary Road, il semblerait que le malheur des Wheeler est lié à un problème de contraception. Si leur premier enfant était arrivé plus tard, si le troisième n’était pas arrivé… Si la contraception et l’avortement avaient été permis, le sort des Wheeler aurait-il été meilleur ? Si on se souvient de notre précédent post et notre diagnostic, les Wheeler souffrent tous les deux de bovarysme, il est fort probable que non. Sara certes ne se suicide pas à la fin du roman, mais n’est pas plus heureuse qu’April, sa fille unique était pourtant désirée. Quoiqu’il arrive, la réalité déçoit les deux héroïnes (bovarysme), elles ne savent pas exister, mais seulement rêver leur existence. Par conséquent, April et Sara (même si sa grossesse était prévue) deviennent mère avant de s’être trouvées comme femme. La maternité ne leur permet pas de se trouver.
On peut donc se demander dans quelle mesure il y a une « question de la maternité ». Il y en a une si, pour reprendre le vocabulaire d’Elisabeth Badinter, on adhère au mythe de la « bonne mère » qui doit s’épanouir en élevant ses enfants. Si on n’adhère pas à ce mythe, l’échec d’April ou de Sara en tant que mère comme leur échec en tant qu’épouse, est à relier au bovarysme. On pourrait analyser de la même façon l’échec de Franck et Todd en tant que mari ou père.
Il n’y aurait donc rien de spécifiquement féminin dans le bovarysme, si ce n’est que peut-être la société encourage davantage les femmes à rêver et à s’échapper de la réalité (plafond de verre, mythes de la bonne mère, de la superwoman etc.). Pour développer cette question, il sera intéressant d’utiliser le livre de Betty Friedan The feminine mystique.
Catégories
Une réponse sur « [club] Yates & Perrotta – La question de la maternité »
Il faudra en effet que nous mettions en relation la féministe américaine et les fictions américaines se déroulant à l’époque où elle écrit.
La question de la maternité est présente dans les deux romans mais ne constitue pas, je te l’accorde, la source du problème : d’ailleurs Emma Bovary elle-même ne trouve pas dans la maternité de solution à son ennui (cf la scène mémorable de la visite à sa fille chez la nourrice).