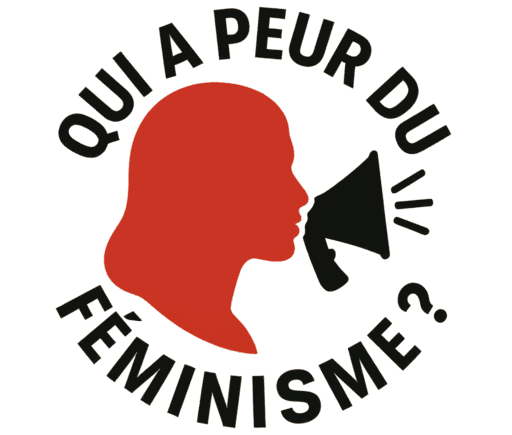Laurence Joseph, psychanalyste, est l’autrice de deux essais : La chute de l’intime paru chez Hermann en 2021 et Nos silences sorti chez Autrement en 2025. Nous lui avons posé trois questions sur l’intime, la libération de la parole et les grandes figures féminines qui incarnent ces thématiques.

Vous présentez dans La chute de l’intime la figure de Mélusine comme emblématique de l’ambivalence de l’intimité : en quoi y a-t-il une spécificité de l’intimité féminine ?
Pour répondre à cette question il faut peut-être d’abord reprendre la définition de l’intimité, qui ne me semble pas être en réalité le tréfonds de nous-même, ce que nous approcherions par des métaphores de profondeur, ou de plongée en soi. L’intime, c’est certainement la possibilité de se laisser transformer et changer par quelque chose qui advient en nous. Et c’est parce que cette chose est différente, qu’elle soit belle ou effrayante que nous souhaitons la soustraire au regard. L’intime c’est la mise en dialogue avec l’altérité, c’est pourquoi la fée Mélusine -une fée bâtisseuse- m’en a semblé la meilleure allégorie. Parce qu’elle porte sur son propre corps un élément qui la rend systématiquement étrangère à elle-même. La traduction de son nom signifie « Brouillard de la mer », elle ne se laisse pas voir.
J’invite chacun à redécouvrir son histoire, pour rappel, sa mère lui a jeté un sort : elle ne pourra se marier que si chaque samedi elle peut s’isoler de son mari pour cacher la queue de serpent qui lui pousse ce jour-là. Mélusine représente finalement une conception classique du féminin : d’une immense beauté, aimante pour ses enfants, elle est aussi un monstre hybride, une créature effrayante à qui son mari Raymondin prêtera la faute de l’adultère. Si l’on est attentif à la légende, on comprend vite que Mélusine subit son intimité mais parvient tout autant à en faire quelque chose, mais là où ne l’attend pas. C’est en effet seulement la nuit que cette fée bâtit la cité, soustraite à tous les regards. Ce qui suppose que le fait de se soustraire, de prendre des temps de retrait est inséparable de la création. Ainsi, là où on attend toujours la question de l’intime et du féminin, c’est-à-dire dans la question anatomique, du sexe caché ou des règles on voit que cette intimité nécessaire à la femme est celle de son désir presque politique, l’empreinte qu’elle laisse dans la cité, c’est ici que son dialogue intérieur se joue finalement avec le plus de conséquences.
L’autre leçon que nous donne Mélusine est celle portant sur l’effraction de l’intime. Raymondin en effet persuadé qu’elle le trompe et pour la suprendre force la porte de la pièce d’eau où Mélusine se cache. Effondrée par la trahison, Mélusine se jette par la fenêtre et erre. Cette figure pour moi est celle de la mélancolie après la rupture des liens, après la trahison. Elle marque la vulnérabilité des femmes, le risque d’être violées, le fait d’être violable et ainsi certainement la nécessité de respecter la pudeur d’une femme à chaque fois qu’elle le demande.
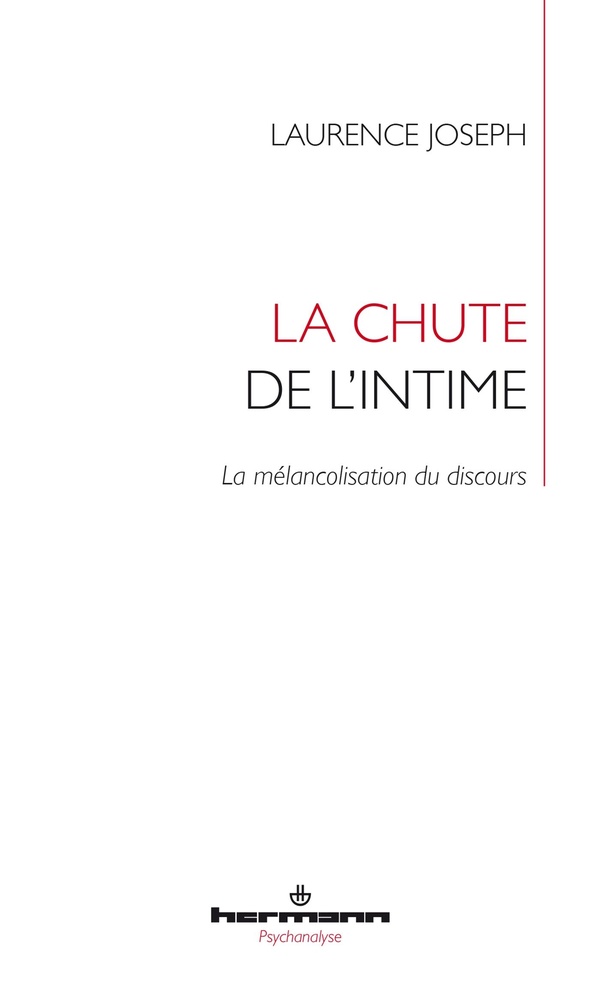
2)Pensez-vous que les femmes ont été particulièrement exposées à la mélancolie, en réaction à une perte de leur intimité, par leur interdiction de disposer, pour citer Woolf d’une chambre à soi
La mélancolie est définie par Freud comme la perte insoluble d’un objet qu’on ne sait pas clairement identifier (à la différence du deuil dont l’objet est lui clairement identifié). Mais ce qui est très juste dans votre question c’est que l’intimité parce qu’elle regroupe autant un regard sur le corps qu’une capacité à créer un monde par le langage peut, si elle est perdue, créer un mouvement mélancolique parce que la parole est plus facilement coupée aux femmes qu’aux hommes. Parce que leur parole est puissante, on considère qu’il faut s’en méfier. Virginia Woolf le démontre prodigieusement dans Une chambre à soi. Je suis également très sensible à l’œuvre de Sylvia Plath qui utilise la parole poétique pour exprimer la place fondamentale de la lutte pour accéder à l’écriture et à la publication pour une femme avec des enfants et à qui de nombreuses taches incombent. On sait au travers de son histoire, de sa fin tragique et des querelles éditoriales avec son mari combien, peu ou prou, cette question traverse le destin de toutes les femmes qui écrivent.
De manière plus contemporaine la question du contrôle coercitif dont la reconnaissance législative est cruciale montre la résistance à laisser une femme occuper, comme elle l’entend, cette « chambre à soi. »
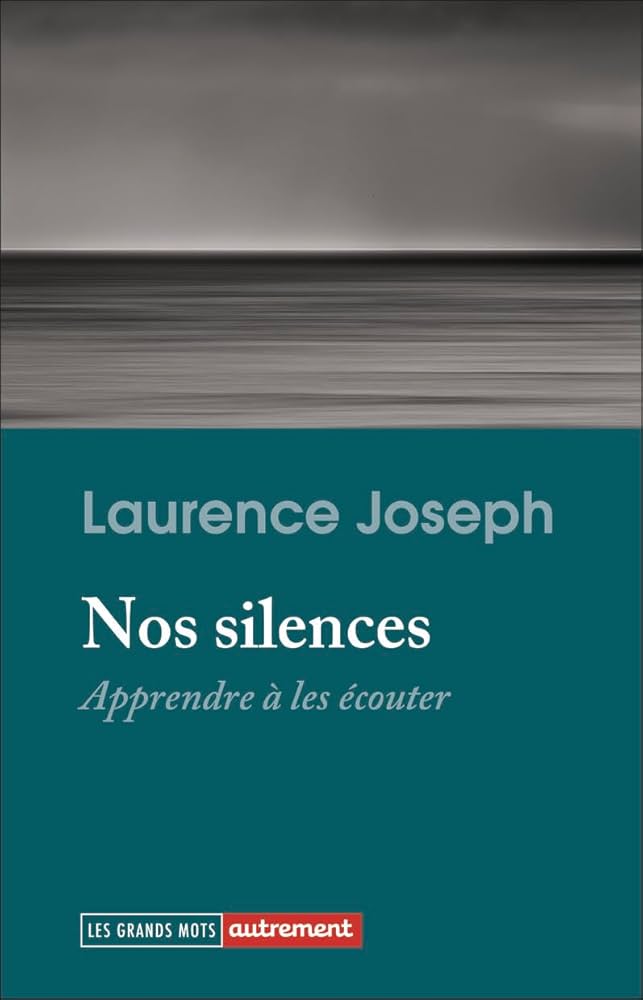
3) Vous mettez en avant dans Nos silences l’importance de cette intimité que constitue le silence : comme dans le mythe de Procné, pensez-vous que le silence est parfois, et paradoxalement la seule arme des femmes pour se défendre ? Libérer la parole est-il toujours possible ou souhaitable ?
Je pense être sensible à cette question de ce que nous cachons, certainement aussi parce que mon métier me donne une place où je suis dépositaire d’une parole qui ne se dépose nulle part ailleurs. J’ai une attention à ce que nous ne disons pas, ou peu, tous ces silences qui ont une fonction de protection, définitive ou transitoire. Se taire parfois fonctionne comme un paravent, un tissu que l’on tend pour se cacher, parce que les choses sont interdites, parce que nous pensons que le regard des autres abimerait ce que nous cachons ou parce qu’il faut du temps parfois pour rendre les choses publiques. Je pense souvent à l’exemple d’une cicatrice après une opération, même bégnine, elle représente une trace de notre histoire, des inquiétudes ou même une volonté mais elle est d’abord une trace personnelle.
Les mots sont des enfants du silence, il faut un temps d’élaboration, d’introspection, pour dire quelque chose, avouer quelque chose.
Je me méfie des obligations systématiques de transparence, des aveux soudains ou systématiques. Le silence est en cela, quand il est choisi une intimité avec soi, l’écoute d’un dialogue intérieur où le sujet se met au diapason de son histoire, de ses accidents ou de ses victoires. Les temps de silence ne sont pas à mes yeux des temps pauvres.
Le silence est-il parfois la seule arme des femmes pour se défendre ?
Peut-être quand elles sont victimes de violence et d’emprise, si elles sont seules ou isolées ( ce qui est généralement le cas). Mais comme le mouvement #meetoo l’a montré, les femmes très vite peuvent -dès lors qu’elles se retrouvent entre elles- créer des dispositifs de solidarité, d’appui commun, de partages des voix, qui leur permettent de prendre la parole sans crainte, avec puissance et efficacité. La sortie du silence se fait de préférence ensemble. C’est pour cela que les lieux d’écoute dédiés aux femmes sont d’une importance capitale comme la Maison des femmes créée par Ghada Hatem.
Pour aller plus loin
Laurence Joseph, La chute de l’intime, Paris, Hermann, 2021
Laurence Joseph, Nos silences, Paris, Autrement, 2025